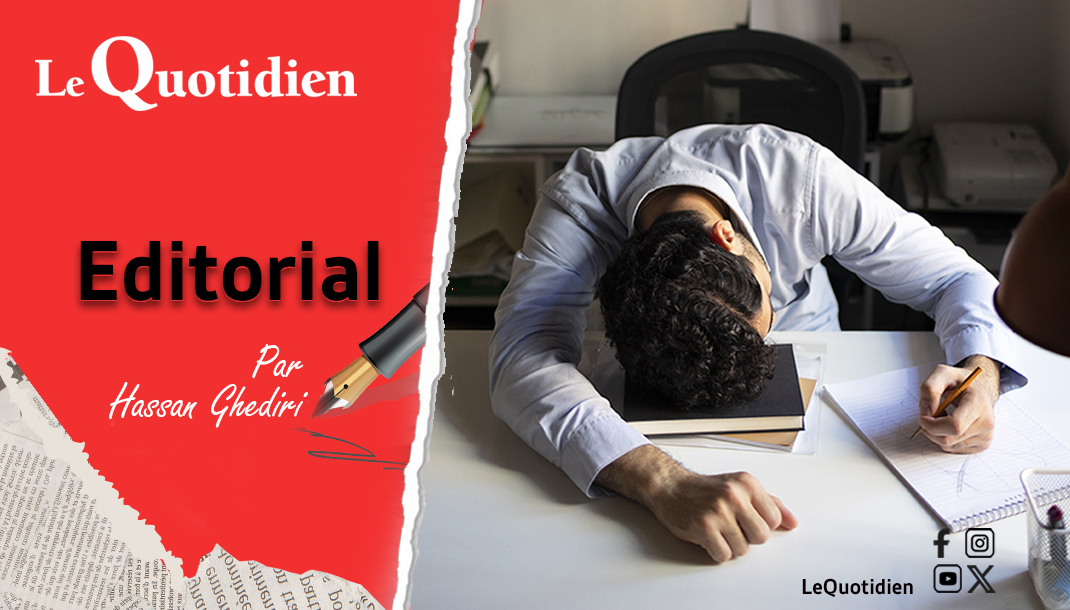Le jeûne n’est malheureusement plus synonyme d’abstinence. Il rime aussi avec «gaspillage». Ramadan qui a perdu, au fil des ans, sa vocation du mois de la privation et de retenue s’est transformé en une opportunité commerciale pendant laquelle le peuple tunisien, presque tout entier, laisse libre cours à ses folies dépensières, gâchant, trente jours durant, des quantités considérables de nourritures et dilapidant des sommes colossales d’argent dans un pays confronté à une pauvreté galopante. Certes, le gaspillage alimentaire n’est pas l’apanage de la Tunisie. Il s’agit bel et bien d’un fléau planétaire que tente, désespérément, de combattre le FAO depuis des années. L’organisation onusienne, dédiée à l’alimentation et l’agriculture, estime que près de 20% de la nourriture produite dans le monde est gaspillée tout au long de la chaine de vente en détail, des services de restauration et des ménages. Diviser par deux cette quantité d’aliments gaspillés permettrait de réduire de plus de 150 millions le nombre de personnes sous-alimentées à l’échelle mondiale.
Le gaspillage alimentaire n’épargne en effet aucune région du monde, mais les Tunisiens s’attachent obstinément à être des champions incontestables de cette « indiscipline ». Pour tenter de résoudre le problème des pertes de nourritures en Tunisie, l’Institut national de la consommation (INC) s’est proposé de piloter ce qui devait être la stratégie tunisienne de la lutte contre le gaspillage alimentaire et ce en collaboration avec le FAO. Constatant que plus de 5% des dépenses alimentaires des ménages tunisiens finissent dans les poubelles, soit un coût annuel global qui avoisinerait 1 milliard de dinars, selon son département chargé des études et des enquêtes, l’INC veut tenter de rompre avec la passivité et passer à l’acte après s’être contenté, pendant des années, à quantifier les pertes et à relayer les chiffres alarmants. L’INC ambitionne de voir des dispositions concrètes pratiques et efficaces de lutte contre le gaspillage alimentaire se mettre sur les bons rails à partir de l’automne prochain. Pour être au rendez-vous de tels objectifs et franchir une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire des mesures fortes doivent être engagées.
Comme dans de nombreux pays, le gaspillage alimentaire est un problème aux multiples facettes. Si les pertes liées à la production et à la distribution sont importantes, une part non négligeable du gaspillage provient directement des foyers. Le citoyen tunisien, souvent inconscient des conséquences de ses actes, joue un rôle clé dans cette chaîne du gaspillage. Il est en effet temps que le consommateur-gaspilleur assume sa responsabilité, y compris financièrement, pour inciter à un changement de comportement.
Très nombreux sont aujourd’hui les Tunisiens qui jettent des aliments sans réaliser l’impact économique, social et environnemental de leurs actes. Pourtant, dans un contexte où le pays est confronté à l’insécurité alimentaire, à l’inflation et aux effets du changement climatique, chaque aliment gaspillé représente une perte colossale irréparable. Pour inverser cette tendance, des mesures incitatives et dissuasives doivent être mises en place, y compris des sanctions financières pour les comportements les plus irresponsables. Dans beaucoup de pays, le fait de faire payer les gaspilleurs a souvent porté ses fruits. Il ne s’agit néanmoins pas de pénaliser les plus vulnérables, mais plutôt de responsabiliser ceux qui gaspillent par négligence ou excès. Chaque pain jeté, chaque légume oublié au fond du frigo représente une perte d’argent et de ressources. Dans un pays où des milliers de ménages peinent à joindre les deux bouts, une prise de conscience à l’égard du gaspillage est cruciale. Faire payer le gaspillage alimentaire ne doit par ailleurs être perçu comme une punition, mais une incitation à agir de manière plus responsable. Il est donc indispensable, aujourd’hui, s’inspirer des expériences des pays qui ont réussi à réduire les pertes de nourritures. Les dons pour les associations doivent être facilités et encouragés. Via des «banques alimentaires», il serait par exemple possible d’exploiter les surplus de nourritures des ménages, des restaurants ou des supermarchés pour les faire bénéficier aux personnes dans le besoin, plutôt que de finir à la poubelle.
H.G.