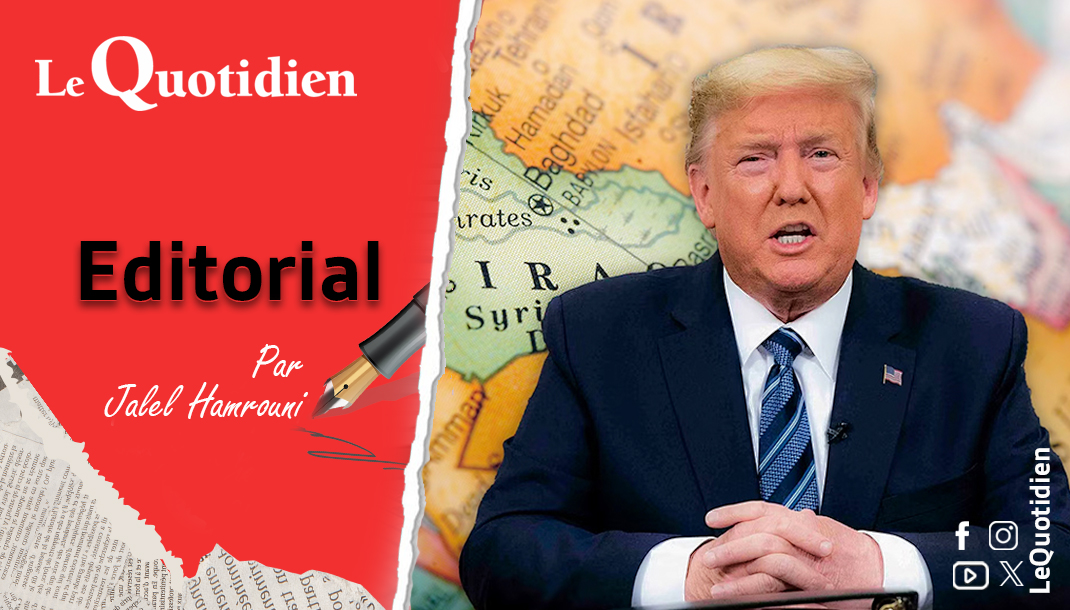Le bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine a repris avec une vigueur inquiétante. «America First», version 2025. Le discours de président américain Donald Trump est connu, la stratégie aussi: ériger des barrières pour relocaliser, renforcer la production nationale et créer de l’emploi. En ligne de mire, la Chine, premier fournisseur des États-Unis et puissance rivale dans presque tous les domaines. Trump accuse Pékin de pratiques commerciales déloyales et veut frapper là où ça fait mal.
Mais le projet va bien au-delà de la Chine. Des sanctions ont visé aussi les pays qui importent des biens chinois pour les réexporter vers les États-Unis. Autrement dit, les alliés commerciaux traditionnels de Washington n’ont pas été épargnés.
À première vue, cette stratégie protectionniste pourrait sembler cohérente avec la ligne «America First» que Trump n’a jamais cessé de revendiquer. L’objectif affiché: relocaliser la production, réduire la dépendance aux importations chinoises, protéger l’industrie américaine et créer de l’emploi. Pourtant, les effets de ces mesures risquent fort de se retourner contre les États-Unis eux-mêmes et bien au-delà de leurs frontières.
La Chine, première puissance manufacturière mondiale, n’a pas tardé à réagir. Pékin a, en représailles, taxé les exportations américaines, notamment dans des secteurs stratégiques comme l’agriculture et les technologies de pointe et a restreint l’accès de certaines entreprises américaines à son vaste marché. Ce jeu de sanctions et de contre-sanctions rappelle la guerre commerciale initiée par Trump lors de son premier mandat, dont les conséquences avaient déjà été sévères: perturbations des chaînes d’approvisionnement, hausse des coûts pour les entreprises et inflation sur les biens de consommation.
Mais le contexte mondial en 2025 est bien différent de celui de 2018. L’économie mondiale sort à peine d’une période de ralentissement post-pandémie, marquée par des tensions géopolitiques multiples, notamment autour de Taïwan et de l’Ukraine, une inflation persistante dans de nombreuses économies avancées, et une défiance croissante vis-à-vis du commerce multilatéral. Dans un tel climat, l’instauration de nouvelles barrières commerciales ne peut qu’aggraver les fragilités existantes.
Les répercussions se font déjà sentir. Plusieurs entreprises américaines ont exprimé leur inquiétude quant à l’augmentation du coût des composants importés, ce qui pourrait se traduire par une hausse des prix à la consommation et freiner la reprise économique. Les marchés financiers ont également réagi avec nervosité, anticipant un possible escalade qui affecterait la croissance mondiale. L’Europe, prise entre deux géants, risque, elle aussi, d’en faire les frais. Certaines entreprises européennes redoutent d’être les victimes collatérales de cette rivalité, en perdant des parts de marché ou en subissant une pression sur leurs chaînes logistiques.
Plus profondément, ce retour au protectionnisme met en péril les principes mêmes du commerce international fondé sur la coopération et la prévisibilité. Il alimente une logique de blocs opposés où chaque nation chercherait à défendre ses intérêts au détriment du bien commun global. Or, dans un monde interconnecté, les grands défis économiques, changement climatique, régulation technologique, sécurité énergétique, nécessitent une coordination internationale, non une fragmentation accrue.
Ainsi, il est essentiel de rappeler que les tensions sino-américaines dépassent le simple champ économique. Elles traduisent une rivalité stratégique de long terme entre deux visions du monde. En cela, la politique commerciale devient un instrument de puissance, voire de confrontation idéologique. Mais si les États-Unis veulent réellement peser face à la Chine, ils doivent le faire en s’appuyant sur des alliances solides et un cadre multilatéral rénové, pas en se lançant seuls dans une croisade tarifaire.
Le monde a changé, et la solution ne viendra ni d’un retour en arrière vers un isolationnisme forcené, ni d’une escalade des sanctions. Il est temps de construire une nouvelle architecture du commerce mondial, plus équitable, plus résiliente, et adaptée aux défis du XXIe siècle. Face à la tentation du repli, l’heure est à la coopération.
Ce bras de fer économique entre les Américains et les Chinois rappelle une réalité incontournable: dans le commerce mondial, il n’y a pas de gagnant absolu. Chaque coup porté à l’autre finit toujours par revenir, d’une manière ou d’une autre.
L’avenir dépendra de la capacité des grandes puissances à renouer le dialogue, à établir des règles équitables et à éviter une nouvelle spirale de sanctions. Car si les logiques de confrontation l’emportent, c’est l’ensemble de l’économie mondiale qui en paiera le prix.
J.H.