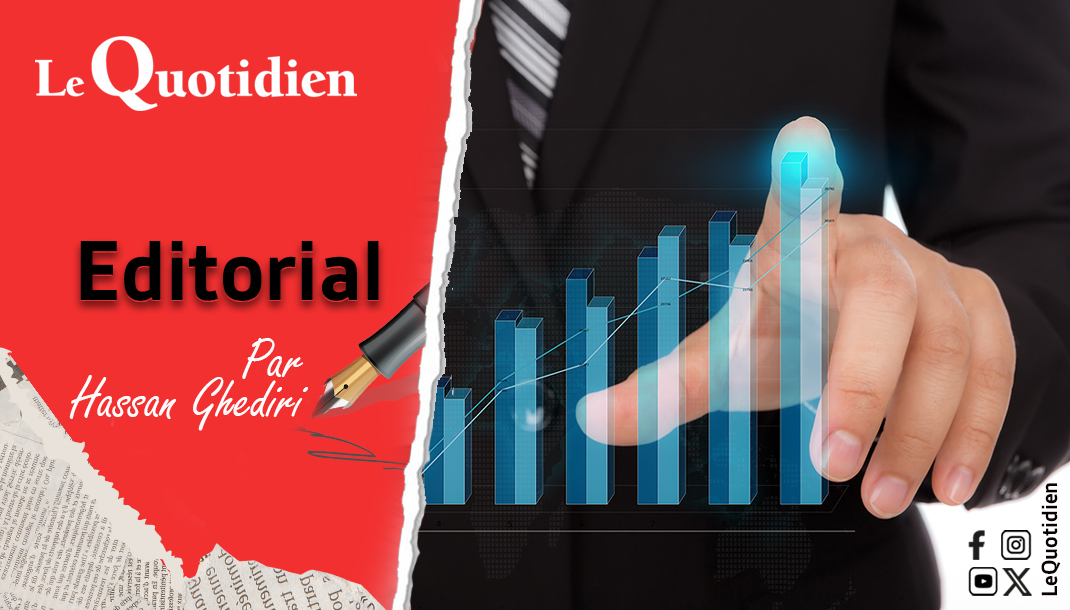Par Hassan GHEDIRI
Comme chaque année, la Tunisie prend part aux réunions du printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), tenues du 21 au 26 avril à Washington. Une délégation officielle, conduite par le ministre de l’Économie et de la Planification, épaulé par le gouverneur de la Banque centrale, y représente le pays. Une présence qui s’inscrit dans une tradition diplomatique désormais bien ancrée, mais dont la portée réelle suscite de plus en plus d’interrogations.
Car si les relations entre la Tunisie et la Banque mondiale restent solides et actives avec plusieurs programmes de développement toujours en cours dans des domaines clés, le lien avec le FMI est quant à lui rompu de fait depuis octobre 2021. À cette date, il faut le rappeler, le conseil d’administration du Fonds s’est opposé au décaissement d’un prêt de 1,9 milliard de dinars, sollicité par Tunis depuis 2018, et ce, malgré la validation du processus par le comité des experts. Depuis, la Tunisie a été abandonnée à son sort. Principal point de discorde : la divergence radicale sur la nature et la portée des réformes économiques proposées par le FMI. L’institution estime ces réformes indispensables pour assurer la viabilité financière de la Tunisie. Mais le président Kaïs Saïed les a catégoriquement rejetées, y voyant une atteinte à la souveraineté nationale et une ingérence intolérable dans les choix économiques et sociaux du pays. Pour lui, céder aux diktats du Fonds veut dire abandonner les principes fondamentaux de l’équité économique et de la justice sociale, sur lesquels il compte bâtir son modèle de gouvernance.
Le divorce est donc consommé, même s’il n’est jamais été officialisé et reconnu. Les échanges entre Tunis et le FMI se limitent désormais à des rencontres protocolaires sans aucun effet procédural. C’est pour dire que les participations de la Tunisie aux sommets annuels de Washington n’ont de finalité que de maintenir une forme de présence, sans espoir tangible de reprendre les discussions sur d’éventuels nouevaux programmes de financement.
Face à ce blocage, la Tunisie a choisi de faire cavalier seul. Et il faut le reconnaître : elle s’en est jusqu’ici relativement bien sortie, malgré les vents contraires. Grâce à une résilience économique certaine et à des partenariats diversifiés, elle a évité l’asphyxie. Mais cette stratégie d’évitement atteint ses limites dans un environnement international de plus en plus instable, où les sources de financement se raréfient et où les vulnérabilités internes se creusent. L’isolement monétaire ne peut toutefois plus durer. Ce constat ne signifie pas pour autant que la Tunisie doit renoncer à ses principes. Bien au contraire, il est urgent de trouver une formule originale et ingénieuse, un équilibre subtil entre indépendance souveraine et coopération pragmatique. Il ne s’agit ni de céder à la logique du diktat financier, ni de s’enfermer dans une posture rigide qui n’ouvre aucune perspective.
L’enjeu est immense : retrouver une crédibilité auprès des partenaires internationaux sans sacrifier l’identité économique et sociale du pays. Cette équation complexe ne peut être résolue que par un effort de diplomatie économique renouvelée, fondée sur la transparence, la vision de long terme et une capacité réelle à proposer des alternatives viables aux schémas imposés. La Tunisie doit réintégrer, à ses conditions, la sphère monétaire mondiale. Car si la souveraineté est un droit, la viabilité économique est un devoir. Les prochaines réunions de Washington ne changeront peut-être rien à court terme, mais elles rappellent l’impératif d’un dialogue réinventé, où le réalisme stratégique et l’affirmation nationale ne s’excluent pas, mais s’articulent dans un projet cohérent.
H.G.