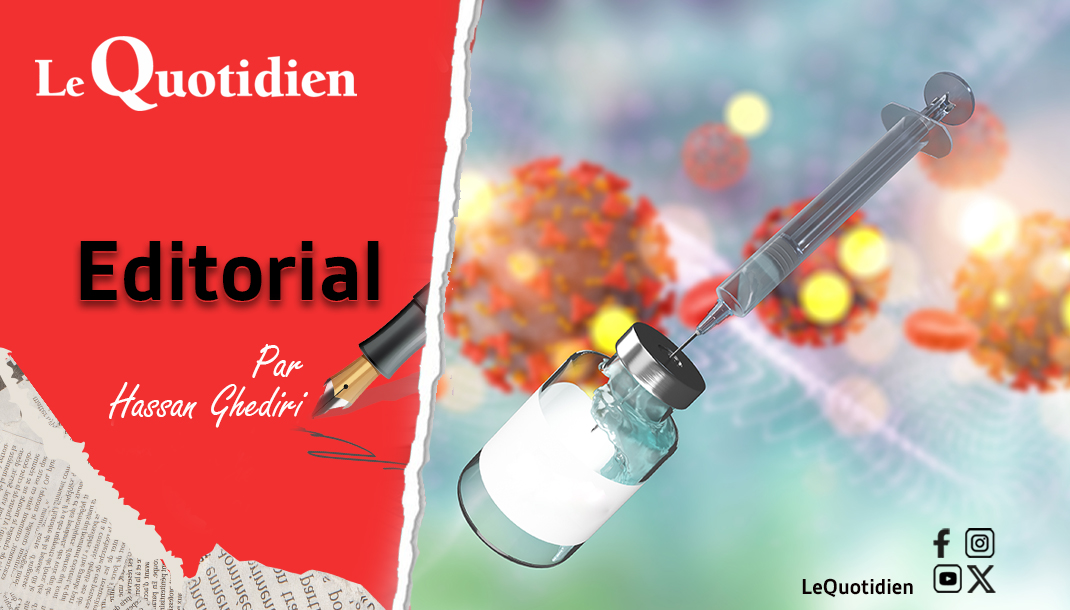La première campagne de vaccination contre le papillomavirus, infection responsable du cancer du col de l’utérus, a démarré hier en Tunisie. Cette maladie qui cause près de 200 décès chaque année sur environ 400 cas dépistés se situe en deuxième rang après le cancer du sein en termes de morbidité chez les femmes. Il a toutefois fallu plus de deux décennies à la Tunisie pour intégrer le vaccin antipapillomavirus dans son calendrier vaccinal national et devenir par le même fait le centième pays à adopter la vaccination comme moyen de prévention contre ce type de cancer. A voir certaines réactions et commentaires des gens sur les réseaux sociaux et dans l’espace public, l’on peut considérer que la campagne ne se déploiera pas avec la fluidité espérée. Une certaine hésitation s’empare de beaucoup de parents qui ne sont pas convaincus de l’utilité du nouveau vaccin et dont bon nombre d’entre eux vont jusqu’à émettre un refus catégorique de la vaccination antipapillomavirus. Dans un contexte de défiance quasi-généralisée envers l’Etat et ses institutions, les gens se montrent réticents envers certaines questions, notamment celles qui touchent la santé.
La pandémie du Covid-19 et les grandes divergences ayant caractérisé le comportement des gens vis-à-vis les vaccins peuvent expliquer l’attitude de beaucoup de parents, aujourd’hui, envers ce nouveau vaccin contre le cancer du col de l’utérins qui cible les jeunes filles. L’on se trouve, presque, en face des mêmes freins ayant motivé l’opposition à la vaccination contre le coronavirus, en Tunisie et un peu partout dans le monde. L’hésitation vaccinale qui a pris la forme, à partir de 2020, d’un mouvement d’opposition très puissant contre les vaccins développés par les laboratoires pharmaceutiques contre les souches particulièrement contagieuses et très virulentes du Sars-Cov-2, semble aujourd’hui être derrière ce qui risque de prendre de l’ampleur et devenir d’ici peu un refus massif du vaccin antipapillomavirus.
L’Etat, qui a attendu environ 20 ans avant de décider, enfin, de mettre la main à la poche et assumer le coût que nécessitera l’introduction du vaccin contre le cancer du col de l’utérus dans le calendrier vaccinal officiel, ne pouvait pas négliger le risque d’un éventuel refus de la vaccination. Déjà quand on est confronté à l’hésitation, c’est déjà un grand danger pour la santé publique. L’Organisation mondiale de la santé, classe d’ailleurs le phénomène de l’hésitation vaccinale parmi les 10 plus grandes menaces pour la santé mondiale. Pour atteindre un taux de couverture globale de 90%, qui est l’objectif déclaré les autorités sanitaires, il faut traverser un long parcours parsemé d’embuches.
Convaincre les parents hésitants nécessite une bonne communication. Car, l’expérience de beaucoup de pays dans le monde qui s’étaient heurtés à des «antivax» dans leur lutte contre papillomavirus a montré que la méfiance, le manque d’information sont les facteurs qui entravent grandement la progression de la vaccination. Généralement, les parents mal informés sont particulièrement influencés par la surmédiatisation, par des canaux de communication non officiels, des effets secondaires graves attribués à cette vaccination. Dans les sociétés conservatrices, la connotation sexuelle du vaccin peut constituer un obstacle infranchissable. Les risques liés au vaccin tendent alors à peser lourdement sur les parents qui ont beaucoup du mal à prendre leur décision. Ceci dit, des pays qui ont intégré depuis très longtemps la vaccination contre le cancer du col de l’utérus, peinent aujourd’hui à impliquer la population cible. En France, où cette vaccination est recommandée depuis 2017, les médias parlent d’un «échec» par rapport aux voisins européens. Malgré une campagne de vaccination contre le papillomavirus, lancée en 2023 par Emmanuel Macron, le faible taux de couverture inquiète énormément les professionnels de santé. Cette vaccination qui n’est pas obligatoire (comme c’est aussi le cas en Tunisie) reste inférieure à 30% d’après les chiffres de 2024. La Tunisie, qui ne veut certainement pas voir échouer son plan vaccinal antipapillomavirus, peut déjà commencer par s’inspirer des expériences comparées réussie et ratées qui démontrent que la confiance est un meilleur antidote contre la défiance.
H.G.