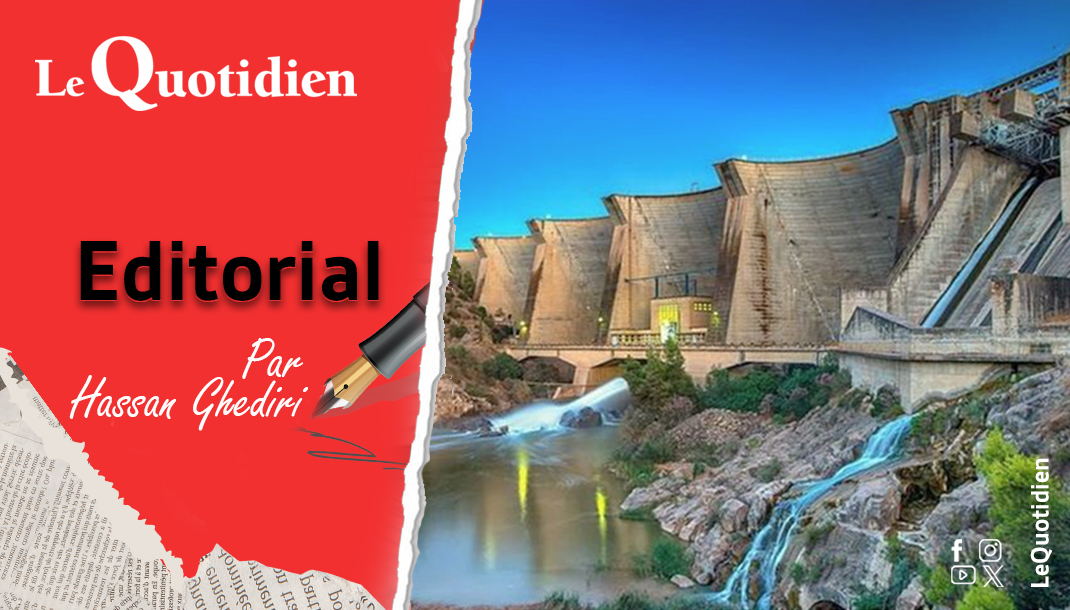Selon les chiffres de la direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques au ministère de l’Agriculture, la quantité d’eau retenue dans l’ensemble des barrages situés au nord et au centre du pays est de 826,104 millions de mètres cubes (m3), et ce, d’après la mise à jour d’hier, lundi 10 février 2025. Le taux de remplissage global de tous les barrages atteint ainsi 34,9% contre seulement 19,6 % à la même date de 2024. Mais avec de telles réserves, le spectre de la soif n’est toutefois pas totalement dissipé parce que la Tunisie est loin d’avoir coché toutes les cases de la sécurité hydrique.
Par ces temps d’incertitudes climatiques, aucun pays n’est épargné des crises liées à l’eau. Avoir des barrages à moitié pleins serait une bonne chose pour la Tunisie qui restera tout de même en situation de stress hydrique. Sa précarité, couplée à une dépendance alimentaire croissante, exige une transformation radicale.
Aujourd’hui, en Tunisie, l’on peut affirmer que le problème de l’eau est un problème agricole par excellence. L’agriculture consomme en effet plus de 80% des ressources en eau. Pis encore, cette quantité est souvent gaspillée par des méthodes d’irrigation archaïques. Secteur clé pour la sécurité alimentaire, l’agriculture souffre particulièrement de la pénurie d’eau, affectant les rendements et la diversité des cultures. Cela se traduit par une hausse des prix des denrées alimentaires, une augmentation de la dépendance aux importations et un appauvrissement des populations vulnérables.
Il est donc essentiel de réagir rapidement, et de manière coordonnée. D’abord, il faut investir dans des infrastructures pour mieux gérer l’eau disponible: modernisation de l’irrigation, lutte contre le gaspillage et développement des techniques de récupération des eaux de pluie. En parallèle, il est crucial de promouvoir des pratiques agricoles durables, pour réduire la dépendance aux ressources en eau. L’introduction de variétés résistantes à la sécheresse et une meilleure gestion des terres agricoles peuvent aussi limiter les pertes.
Une telle stratégie nécessite une mobilisation forte de toutes les parties prenantes: les autorités, les agriculteurs, les chercheurs et la société civile. Le défi est de taille, mais il est possible de renforcer la résilience du pays face à la crise hydrique et de garantir un avenir alimentaire sécurisé pour tous. Il est plus que jamais nécessaire de commencer ce processus aujourd’hui pour ne pas risquer de compromettre les générations futures.
L’Etat, qui manque d’engager des mesures permettant d’amortir les effets du réchauffement climat, ne peut toutefois rester les mains croisées devant la dilapidation des ressources hydriques. La surexploitation sauvage et illicite des nappes phréatiques est un fléau qui aggrave la pénurie. La révision de la législation organisant les forages avec éventuellement un durcissement des sanctions s’impose. La création d’une agence autonome, associant experts et société civile, pourrait aider à une meilleure régulation dans ce domaine et garantir un usage rationnel et équitable des ressources. Il est absurde que le nouveau code de l’eau tarde encore à voir le jour. Il est plus que jamais urgent que le code actuellement en vigueur datant de 1975 soit révisé fondamentalement pour intégrer les enjeux climatiques et renforcer la résilience hydrique de l’agriculture. En effet, la problématique de l’eau est aussi une question de souveraineté alimentaire. La Tunisie importe aujourd’hui plus de 70% de ses besoins alimentaires, ce qui explique sa grande vulnérable aux crises internationales.
H.G.